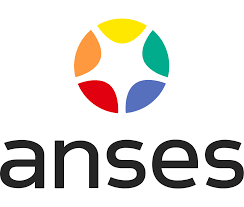Les connaissances scientifiques : Les travaux en cours pour mieux comprendre l’impact de la chlordécone sur la santé
Publié le – Mis à jour le
Kannari 1 et 2 : étudier l’exposition des populations, à 10 années d’intervalle
Santé publique France a lancé l’étude Kannari 2 en Guadeloupe et en Martinique pour suivre l’évolution de l’exposition des populations à la chlordécone et à d’autres polluants.
L’étude Kannari 2 a pour objectifs :
- De mesurer l’évolution des niveaux d’imprégnation de la population à la chlordécone, 10 ans après la première étude Kannari.
- D’évaluer l’imprégnation à une sélection d’autres molécules (pesticides et métaux lourds), dont certains pour la première fois comme le glyphosate, les métabolites des pyréthrinoides et plusieurs métaux lourds (plomb, arsenic, mercure).
- D’identifier les facteurs qui sont associés au niveau d’imprégnation élevé dans la population.
- D’étudier l’imprégnation des populations plus sensibles (enfants et femmes en âge de procréer) et plus exposées (travailleurs agricoles, pêcheurs, personnes résidant en zone contaminée).
- De mesurer les connaissances et l’adoption des recommandations alimentaires visant à réduire l’exposition à la chlordécone.
Après une phase pilote entre juin et octobre 2023, le protocole a été ajusté et l’étude lancée à grande échelle de janvier à juillet 2024. L’objectif est d’inclure 3 000 personnes à l’étude dont 700 enfants, âgés de 6 ans ou plus. Cette étude repose sur le volontariat des personnes tirées au sort. Un site internet dédié , est mis en place pour répondre aux questions.
L’étude ChlorExpo : évaluer l’exposition alimentaire de la population au regard des habitudes d’approvisionnement et de préparation des aliments
Dans la continuité de la compréhension de l’exposition alimentaire de la population des Antilles à la chlordécone, l’Anses a lancé en 2021 l’étude ChlorExpo. Les objectifs de l’étude sont :
- D’affiner l’estimation de l’exposition de la population des Antilles en prenant en compte les modes d’approvisionnement et les pratiques de préparation et cuisson actuelles.
- D’identifier et de quantifier plus précisément les marges de manœuvre concernant les risques alimentaires de la population des Antilles.
- De proposer, si possible, des recommandations pratiques fondées sur la préparation et la cuisson des aliments permettant potentiellement à chacun de limiter son exposition à la chlordécone par voie alimentaire.
- Les objectifs de l’étude sont étroitement liés à la prévention de l’exposition de la population des Antilles vis-à-vis de la chlordécone dans leur alimentation.
Le plan d’échantillonnage alimentaire a été établi en 2021, à partir d’une enquête portant sur les circuits d’approvisionnement, la préparation et la cuisson des aliments aux Antilles. Environ 1 500 échantillons ont été collectés et préparés en 730 échantillons composites1 entre mi-2022 et mi-2023. L’analyse des échantillons s’est déroulée sur 2024, et le calcul des expositions se fera début 2025.
1 Les échantillons composites sont des échantillons qui regroupent plusieurs prélèvements pour une seule analyse. Par exemple, si on veut analyser des patates douces dans un jardin familial, on va prélever plusieurs patates à différents endroits du jardin afin d’avoir une analyse qui corresponde le plus possible à l’ensemble du terrain analysé.
TIMOUN : Poursuite de l’étude de cohorte mère-enfant – évaluation de l’impact des expositions sur le développement de l’enfant et de l’adolescent
L’étude épidémiologique de cohorte TIMOUN, menée par l’Inserm, a pour objectif d’évaluer l’impact sanitaire des expositions à la chlordécone et autres polluants organochlorés sur le déroulement de la grossesse et le développement pré et postnatal, de l’enfant de 7 ans, puis à l’âge péri-pubertaire. Cette cohorte est constituée d’un millier de femmes suivies avec leurs enfants depuis leur grossesse, qui a eu lieu au cours de la période 2004-2007.
Les premières participations ont eu lieu fin décembre 2022 pour la poursuite de travaux d’analyse. Et on compte 85 participation fin décembre 2023.
Les résultats sont publiés au fur et à mesure depuis le lancement de la cohorte.
KARU FERTIL : étudier le lien entre exposition à la chlordécone et la fertilité des femmes
Les objectifs de ce projet sont d’étudier l’association entre l’exposition à la chlordécone et l’infertilité féminine, en particulier sur les marqueurs de réserve ovarienne (hormone de régression müllerienne [AMH] et compte folliculaire antral [AFC]) et d’étudier l’impact de la chlordécone sur l’expérience et la représentation des femmes infertiles et des professionnels de santé prenant en charge les couples infertiles.
Ce projet est construit sur deux approches complémentaires : épidémiologique et sociologique. Toutes les femmes âgées de 18 à 39 ans consultant pour infertilité de couple au CHU de Guadeloupe sont éligibles pour participer à l’étude épidémiologique. Dans le cadre de leur bilan de routine, les femmes auront des mesures d’AMH et une échographie endovaginale pour l’AFC. À l’inclusion, toutes les causes médicales potentielles liées à l’infertilité sont enregistrées et les femmes remplissent un questionnaire.
Des échantillons de sang sont prélevés au même moment pour mesurer la chlordécone. À titre exploratoire, les associations entre la chlordécone et les causes médicales les plus fréquentes d’infertilité féminine sont étudiées (syndrome des ovaires polykystiques, endométriose, réserve ovarienne diminuée), au moyen d’études cas-témoins. Un total de 634 femmes sera inclus. Pour l’approche sociologique, des entretiens semi-structurés seront réalisés sur un échantillon de femmes incluses dans l’étude épidémiologique (n = 40 attendus) et sur un échantillon de professionnels de santé (n = 20 attendus) prenant en charge l’infertilité du couple en Guadeloupe. Ces entretiens feront l’objet d’une analyse thématique afin d’analyser leurs représentations de la chlordécone et de ses impacts sur l’infertilité.
La fin prévisionnelle des travaux est annoncée pour 2026.
Poursuite de l’étude de cohorte KP-Caraïbes portant sur le cancer de la prostate
Une nouvelle étude de cohorte prospective est en cours de mise en place (cohorte KP-Caraïbes-Breizh). Il s’agit de suivre de manière longitudinale au cours du temps, des patients atteints de cancer de la prostate. L’objectif étant de caractériser les déterminants environnementaux, professionnels,
cliniques et génétiques d’évolution (récidive, métastases…) de la maladie et pouvant provoquer des complications (urinaires, sexuelles…) en fonction des différents parcours thérapeutiques.
Cette étude, qui associe onze équipes cliniques et de recherche, portera une attention particulière aux contaminants environnementaux (dont la chlordécone) et sera réalisée en Guadeloupe et en BretagneLa fin prévisionnelle des travaux est annoncée pour 2028.
CHLOECAPA : programme de recherche pluridisciplinaire visant à approfondir la compréhension du rôle de la chlordécone dans le risque de survenue du cancer de la prostate, ainsi que sa perception et ses conséquences sociales dans les Antilles.
Ce consortium est divisé en 4 « Work Packages » (WP) :
- WP 1 : Etude des données préexistantes (2010-2019) des registres des cancers et de la cartographie de l’évaluation de l’exposition
- WP2 : Etude épidémiologique as-témoin en Martinique
- WP3 : Sciences humaines et sociales – Etude de l’expérience individuelle, des mobilisations sociales et des dispositifs institutionnels liés à la contamination
- WP4 : Biologie – Etude de la distribution de la chlordécone dans le sang, le tissu gras et le tissu de la prostate, et des effets de l’exposition à la chlordécone sur les marqueurs d’agressivité du cancer de la prostate
Il a été lancé en novembre 2021, à l’occasion d’un séminaire d’ouverture ; et est suivi annuellement par un comité scientifique international pour le soutien scientifique, et par un comité d’appui qui suit l’exécution du programme et peut apporter un soutien à la mise en œuvre.
Cohorte des travailleurs de la banane
Afin d’explorer le lien entre l’exposition aux pesticides, notamment la chlordécone, et les maladies chez les travailleurs de la banane, l’Inserm et Santé publique France analysent une cohorte de plus de 10 000 travailleurs.
Ce travail vise à étudier les causes de mortalité en fonction de l’exposition aux pesticides et à évaluer l’incidence des cancers et maladies neurodégénératives chez les travailleurs exposés entre 1973 et 1993.
L’étude intègre des données de mortalité de 1981 à 2015 et prend en compte les caractéristiques des travailleurs de la banane et des exploitations ainsi que les niveaux d’exposition à la chlordécone et à d’autres produits phytosanitaires.
Étudier les liens entre exposition à la chlordécone et risque d’hémopathies malignes : myélome multiple et lymphome non hodgkinien
L’étude a pour objectif d’étudier le rôle de l’exposition environnementale et professionnelle aux pesticides dans le développement des myélomes multiples (MM) et autres lymphomes non-hodgkiniens (LNH) dans les Antilles françaises.
L’origine des LNH est multifactorielle impliquant des facteurs génétiques, viraux et environnementaux (exposition aux pesticides notamment). Une étude a confirmé l’existence d’un lien entre exposition professionnelle aux pesticides et des sous-types de LNH.
De nombreuses études ont évoqué le rôle d’expositions à des facteurs environnementaux et professionnels dans la survenue du MM, et une présomption forte a été établie entre l’exposition aux pesticides et le risque de survenue de MM. En Guadeloupe et en Martinique, l’incidence du MM est plus élevée que dans l’Hexagone. En Martinique, une étude de corrélation géographique a mis en évidence une incidence élevée de MM chez les individus résidant sur des sols pollués par la chlordécone.
L’objectif principal est de mesurer l’association entre exposition aux pesticides, en particulier à la chlordécone, et à d’autres facteurs environnementaux et professionnels avec la survenue des MM et autres LNH en Guadeloupe et en Martinique.
Cette étude a commencé en novembre 2020 et est menée par les équipes en charge des registres des cancers de Guadeloupe et de Martinique, pilotée par Santé publique France. L’inclusion des cas et des témoins s’est terminée en décembre 2023. L’analyse statistique des données et l’interprétation des résultats sont en cours.
Étudier les liens entre exposition à la chlordécone et risque de cancer
Ce projet vise à étudier la corrélation entre la cartographie des sols contaminés et la géolocalisation des cas de cancers à partir des données des registres généraux des cancers.
Le projet de cartographie s’appuie sur les données des registres pour les cancers diagnostiqués entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2017, soit 10 ans d’incidence et plus de 18 000 cas par registre sur la période. Le recueil de l’adresse de résidence permet la géolocalisation des cas pour des études écologiques. Il associe en Guadeloupe, l’équipe du registre des cancers, le CIRAD (centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement) et la DAAF (Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) et en Martinique, le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) pour les aspects environnement des polluants.
Télécharger
-
AVIS et RAPPORT révisés de l’Anses relatif aux valeurs sanitaires de référence (VSR) pour le chlordécone
Les acteurs engagés
- CPSN (Comité de Pilotage Scientifique National)
- ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail)
- Santé Publique France
- INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale)
- IRSET (Institut de Recherche en Santé Environnement et Travail)